Martin Hervieux est un Innu de la communauté de Pessamit au Québec. Il aurait profondément souhaité que son père ait eu accès à des ressources d’aide psychologique il y a plusieurs dizaines d’années quand la violence paternelle dominait la vie de famille.
« J’aurais tellement aimé que les hommes violents comme l’était mon père aient eu accès à une maison où ils auraient pu chercher de l’aide. Il battait constamment ma mère, » souligne Martin Hervieux un homme aujourd’hui âgé de 59 ans. « Une telle ressource aurait vraiment pu m’être utile aussi durant ma vie adulte. »
Monsieur Hervieux est aujourd’hui membre du comité Napeuat (pour les hommes). Il est aussi l’un des encore rares hommes – mais leur nombre est croissant – qui veulent prendre à bras le corps le sérieux problème de la violence familiale au sein des communautés autochtones au Québec.
Il y a trois ans, quand le comité Napeuat a décidé de construire un refuge pour hommes amérindiens et de leur offrir un service psychologique d’aide pour faire face aux comportements violents, ses membres se sont tournés vers l’expertise du Réseau canadien des maisons d’hébergement pour femmes pour des conseils.
Au cours des premières rencontres, Martin Hervieux avoue « avoir eu peur.»
Les membres du comité Napeuat étaient en minorité. « Il y avait 14 femmes, dont quatre féministes radicales. Nous avons raconté nos histoires personnelles, nous avons expliqué notre projet et la plus radicale d’entre elles nous a demandé de faire partie de leur réseau. Nous avons immédiatement dit oui. »
Martin Hervieux a connu la violence, la discrimination et le racisme
« Nous n’avons pas été confinés dans des écoles résidentielles, mais les religieuses au village nous disaient constamment que nous étions des moins que rien. Et je n’avais pas encore 10 ans, » se souvient Martin Hervieux.
« Il y avait toujours de l’alcool au village, de l’alcool qui arrivait pas la rivière ou par la forêt. J’ai commencé à boire quand j’avais 13 ans, j’ai été arrêté et battu par les agents de la GRC (Gendarmerie royale). Toute notre famille buvait. Je me souviens d’une fois où j’avais vraiment trop bu. Je me suis réveillé avec une gueule de bois et mon père était mort. Je ne me souviens de rien. J’ai été condamné à sept ans de prison. »
À sa libération, Martin Hervieux n’avait plus d’endroit où aller. Il s’est retrouvé sans abri dans les rues de Montréal.
« J’étais alcoolique, accro à la cocaïne. Je n’avais rien d’autre que les vêtements que j’avais sur le dos… et la volonté de m’en sortir. »
Sobre depuis 22 ans, Martin Hervieux est un des rares hommes qui fait partie du mouvement des femmes autochtones du Canada.
Système punitif pour les hommes autochtones
Par contre, le Québec a la triste réputation de trainer de la patte derrière les autres provinces canadiennes et les territoires en matière de services offerts aux hommes autochtones. C’est ce qu’affirme la criminologue et professeure Renée Brassard de l’Université Laval de Québec. « Nous avons un système punitif. Pas de crime? Pas de services. »
Madame Brassard publiera une étude au printemps qui fera état des constatations de son équipe de recherche auprès d’hommes amérindiens et Inuits emprisonnés au Québec.
« Nous avons constaté qu’un très grand nombre d’entre eux étaient intoxiqués au moment où ils ont perpétré leur crime. De plus, les épouses étaient aussi intoxiquées et très violentes. »
S’il y a un manque flagrant de ressources pour venir en aide aux hommes autochtones aux prises avec des actes de violence conjugale, il y a aussi un manque profond de données solides sur le sujet.
Sheila Swasson, membre fondatrice du Cercle national autochtone contre la violence familiale, et défenderesse de la communauté Mi’gmaq de Listiguj, ne s’étonne pas de la chose.
« À un très jeune âge, on inculque aux hommes d’être forts. Mais, ils doivent apprendre à ne pas avoir honte de demander de l’aide. Les conséquences de l’assimilation des écoles résidentielles sont encore très présentes. De plus, la violence commence tellement tôt dans la vie qu’elle devient presque la norme. »
Inviter les hommes à être partie prenante du mouvement
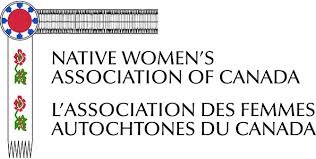 « Dès les débuts du Cercle national autochtone contre la violence familiale, les femmes autochtones ont été les premières à demander aux organisations féministes du Québec d’inclure les hommes à leurs actions pour mettre fin à la violence familiale », se souvient Michelle Audette, présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.
« Dès les débuts du Cercle national autochtone contre la violence familiale, les femmes autochtones ont été les premières à demander aux organisations féministes du Québec d’inclure les hommes à leurs actions pour mettre fin à la violence familiale », se souvient Michelle Audette, présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.
« Quand la Fédération des femmes du Québec nous a demandé de prendre part à la marche de la Journée internationale des femmes du 8 mars en 2000, nous avons accepté en mettant comme condition que des hommes y soient impliqués. Elles ont d’abord refusé avant de changer d’avis.»
Sheila Swasson, qui gère aussi le refuge pour femmes de Listiguj, Haven House, change peu à peu l’approche du centre afin que des hommes, jeunes comme aînés, y participent.
Il reste pourtant tant à faire.
Martin Hervieux voit avec regret les coupes qui se font dans les budgets des services sociaux au Québec. Il espère que des initiatives telles celle de la Campagne du ruban blanc incitera plus d’hommes à s’investir dans des relations saines et de chercher de l’aide quand ils sont dans le besoin.
« Quand je partage mon histoire personnelle, cela m’aide à guérir. »









Pour des raisons indépendantes de notre volonté et, pour une période indéterminée, l'espace des commentaires est fermé. Cependant, nos réseaux sociaux restent ouverts à vos contributions.