Comme bien des virus respiratoires, le coronavirus est capable d’étendre ses tentacules jusque dans nos neurones et dans notre cerveau selon la sévérité des cas.
Les travaux de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) permettent d’avoir de nouvelles données les effets du coronavirus responsable de la COVID-19 dans l’organisme d’une personne contaminée.
Jusque-là, on savait que ce virus s’attaquait avant tout au système respiratoire (nez, gorge, poumons). C’est du moins ce que les recherches préliminaires ont permis de constater. Cette variante du virus de la famille des coronavirus est nouvelle avec des répercussions plus importantes. Les chercheurs sont parvenus à se prononcer sur les possibilités de dommages au cerveau en raison de la capacité des coronavirus d’envahir le système nerveux central.
Nous nous sommes entretenus avec le chercheur principal de cette étude basée sur une recherche précédente. Cette recherche a permis d’observer que l’infection du système nerveux central pourrait avoir pour origine une infection des neurones olfactifs. Elle fait l’objet d’une revue de la littérature publiée en janvier dans le journal Viruses.
Les travaux de Pierre Talbot, chercheur à l’INRS, spécialiste des maladies neurologiques virales et directeur du laboratoire de neuro-immunologie du Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie à Laval, nous permettent de comprendre un peu plus la dynamique des coronavirus dans l’organisme et la façon dont ils peuvent s’attaquer au système nerveux central.
Comment le virus se rend-il jusqu’au cerveau?
Chez les patients touchés, il n’est pas rare qu’on entende parler de perte du goût et de l’odorat, observe le chercheur qui soutient qu’il y aurait des liens entre cette perte et l’atteinte des neurones olfactifs.
Des travaux précédents du chercheur ont permis d’observer ce même phénomène chez des souris atteintes par les coronavirus du rhume.
La perte de l’odorat peut être réversible en raison du processus naturel de régénération, indique dans le communiqué Marc Desforges, spécialiste en biologie médicale au laboratoire de virologie du CHU Sainte-Justine à Montréal, qui a travaillé aux côtés de M. Talbot.
Lorsque le virus a franchi les premiers neurones infectés dans la cavité nasale, les neurones du centre de l’odorat peuvent être ensuite touchés. Malgré les barrières solides autour du cerveau, le virus réussit dans de rares cas à les traverser pour s’attaquer au cerveau.
Selon la recherche, les situations où le virus réussit ainsi à passer les murs protecteurs autour du cerveau pour l’envahir sont moins susceptibles de se produire en raison de la capacité de l’organisme à s’organiser pour opposer une réponse immunitaire rapide au virus.
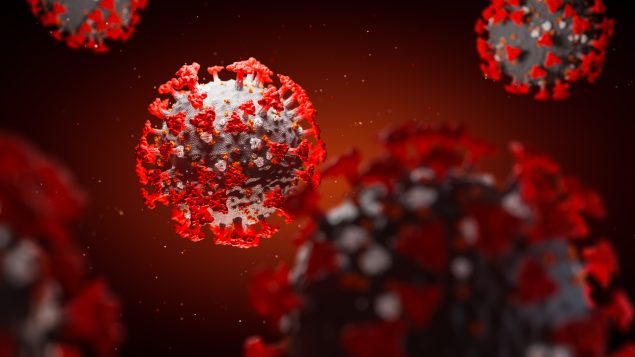
Le coronavirus est un virus très puissant avec un facteur de multiplication très élevé en raison du taux de mortalité, et du nombre de personnes qui peuvent être contaminées par une personne infectée. Photo : iStock
Quelles sont les personnes les plus à risque de connaître un tel développement?
Par contre, dans le communiqué, Marc Desforges relève que chez les personnes présentant une condition sanitaire plus fragile, à l’instar des personnes âgées, des très jeunes enfants et des personnes ayant subi une greffe et qui prennent des médicaments antirejet, les possibilités pour que le virus traverse et touche le cerveau sont plus élevées que chez la population générale.
Cela pourrait se traduire par une inflammation au cerveau (encéphalite) et de graves dommages, voire la mort des patients.
« Durant la rédaction de notre article de revue de la littérature, nous avons remarqué que les encéphalites virales arrivaient rarement. Pour celles engendrées par le virus de l’herpès par exemple, on peut penser à moins d’un cas sur 10 000. Ça reste important à considérer, car lorsque l’inflammation se produit, c’est très dangereux : un mort sur deux à un mort sur quatre selon différentes études », constate Marc Desforges dans le communiqué.
Possibilité de rester avec des séquelles?
Il n’existe pas encore de données probantes attestant de cette possibilité. Mais M. Talbot, qui étudie les coronavirus depuis 40 ans, pense qu’une telle possibilité ne devrait pas être exclue, en raison des résultats d’études similaires portant sur les dommages au cerveau du coronavirus du rhume chez les souris.
En raison de la ressemblance entre les maladies neurodégénératives observées chez les souris atteintes par le coronavirus du rhume et les problèmes de santé liés à la sclérose en plaques, à l’alzheimer et à la maladie de Parkinson, le chercheur croit que des dommages semblables pourraient survenir chez les personnes dont le cerveau a été touché par le coronavirus responsable de la COVID-19.
Cette possibilité est étoffée par un autre constat d’attaques au cerveau observées en 2003 durant l’épidémie de SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère).

Le chercheur Pierre Talbot de l’INRS entouré de son équipe, notamment son ancien associé de recherche Marc Desforges (à sa droite), dans son laboratoire de neuroimmunovirologie au Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie à Laval. Photo : INRS
C’est cette propagation qui est à l’origine de maladies neurologiques qui ressemblent à certaines maladies du même type chez les humains : encéphalite, sclérose en plaques, alzheimer, Parkinson. Les pertes d’odorat rapportées avec l’éclosion de la COVID-19 seraient donc intimement liées à une infection du nerf olfactif telle que constatée chez la souris. C’est donc par analogie à leurs travaux avec le coronavirus sur le rhume que le chercheur et son équipe ont émis l’hypothèse selon laquelle le processus d’attaque au cerveau serait le même avec le SRAS-COV-2. Cette même hypothèse est présente dans la littérature scientifique sur la question.
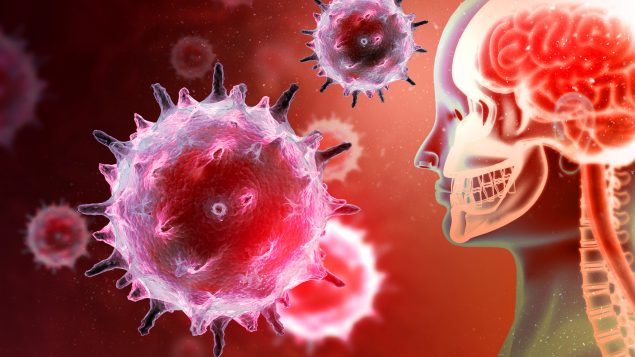







Pour des raisons indépendantes de notre volonté et, pour une période indéterminée, l'espace des commentaires est fermé. Cependant, nos réseaux sociaux restent ouverts à vos contributions.