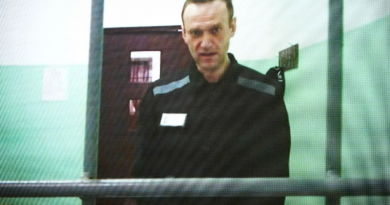Combattre le feu par le feu : le rôle du brûlage dirigé au Yukon

Selon une étude récente menée par l’équipe du projet POLIS Wildfire Resilience à l’Université de Victoria, en Colombie-Britannique, le feu en tant qu’élément naturel pourrait contribuer positivement à la capacité d’adaptation future face aux incendies forestiers.
Au Yukon, ce n’est pas une idée récente : tant le gouvernement que les communautés autochtones s’intéressent au feu pour prévenir les incendies dévastateurs. Toutefois, en tirer profit sans subir ses conséquences destructrices nécessite une gestion habile.
Les changements climatiques font en sorte que les feux de forêt deviennent plus intenses et plus fréquents, mais ils font toujours partie du cycle naturel de la forêt boréale du Yukon.
Les feux favorables
Le rapport (nouvelle fenêtre) (en anglais) suggère de considérer certains feux comme favorables
s’ils ont un effet positif sur l’écosystème et présentent un niveau de risque tolérable
pour les communautés voisines.
Cette désignation comprend le brûlage culturel, le brûlage dirigé et les incendies sous la supervision de spécialistes.
Andrea Barnett, analyste et responsable du projet POLIS, soutient que ce rapport propose des méthodes que les communautés pourront adapter à leurs besoins afin d’utiliser le feu pour se défendre contre les incendies les plus dévastateurs à l’avenir.
« Il est essentiel qu’elles comprennent les origines du feu, leurs propres vulnérabilités et la tolérance au risque de leur collectivité. »
Une histoire liée au feu
Sean Smith, chef de la Première Nation Kwanlin Dün, affirme que le feu fait partie de l’héritage culturel
de son peuple.
« Les gens à l’époque étaient conscients que c’était un outil extrêmement puissant, mais également très dangereux »
, affirme-t-il.
La communauté craint de plus en plus les incendies de forêt en raison des changements climatiques.
« La forêt nous entoure. Certaines zones sont très denses, avec beaucoup d’arbres morts… C’est le combustible pour le feu. »
Kwanlin Dün a élaboré sa propre stratégie de gestion des incendies de forêt en collaboration avec la Première Nation Carcross/Tagish et le gouvernement du Yukon, qui vise à protéger certains endroits précieux et à intégrer des valeurs traditionnelles, comme le brûlage culturel.
John Fingland souligne également la relation des peuples autochtones avec le feu.
« [Autrefois,] si nous arrivions près d’un autre village et que nous voulions nous annoncer, nous mettions le feu à un arbre. Cela indiquait que des gens s’approchaient et que le village savait qu’il était en sécurité, car le feu avait été aperçu. »
C’est ce que raconte l’historien et membre des Premières Nations Champagne et Aishihik.
La lutte contre les incendies a commencé avec l’arrivée des colons et a eu pour conséquence d’augmenter les risques pour les villages, car les incendies sont aujourd’hui ingérables, d’après lui.
Sa communauté collabore avec la Première Nation Kluane et le parc national Kluane pour restaurer la forêt grâce au brûlage traditionnel.
Protéger la forêt et l’atmosphère
Le gouvernement du Yukon appuie aussi le brûlage dirigé. Il laisse également brûler des feux dans les régions éloignées du territoire.
« Dans la mesure du possible, nous souhaitons que le feu continue de jouer son rôle naturel dans la forêt boréale »
, déclare Haley Ritchie, responsable des communications sur les incendies de forêt au Yukon.
« Cela peut contribuer à prévenir les incendies dévastateurs », ajoute-t-il.
Cependant, le réchauffement climatique perturbe le cycle naturel du feu dans la forêt boréale, selon Jill Johnstone.
Le cycle typique dure de 50 à 200 ans environ, indique la chercheuse de l’Université du Yukon et de l’Alaska à Fairbanks. Cependant, dans un cycle plus rapide, certaines espèces, par exemple les conifères, n’ont pas le temps de se rétablir.
L’intensité des feux d’aujourd’hui fait en sorte qu’ils émettent plus de carbone dans l’atmosphère, note-t-elle.
Elle suggère donc que le brûlage dirigé ait lieu au printemps, quand le sol est encore humide, afin de limiter les incendies plus violents de l’été, qui produisent davantage de carbone.
Avec les informations de Tori Fitzpatrick
À lire aussi :
- Certains feux de camp interdits au Yukon parce que les risques d’incendie augmentent
- De nouveaux feux de forêt découverts dans le Grand Nord canadien
- Une étude sur l’arsenic libéré par les feux de forêt de Yellowknife sème l’inquiétude