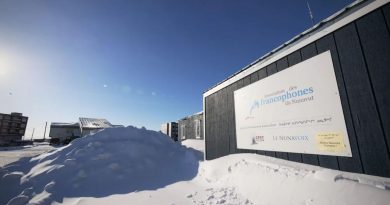Analyse | Faut-il réformer les conférences de l’ONU sur l’environnement?

Les grands sommets des Nations unies sur l’environnement sont accusés de perpétuer l’inaction. Face à l’accélération des crises de la biodiversité, du climat et de la pollution par le plastique, faut-il réinventer les façons de faire?
Les conférences de l’ONU sur les grandes questions environnementales sont-elles toujours utiles? Je ne compte plus le nombre de fois où je me fais poser cette question. Et s’il y a une année où la question mérite d’être posée, c’est bien en 2024.
Disons d’emblée ceci : malgré leurs insuccès et les limites auxquelles elles se heurtent, ces grandes réunions sont toujours utiles. Non pas parce qu’elles constituent la solution idéale – loin de là – mais parce qu’il n’existe pas vraiment de solution de remplacement viable. Et parce que, contrairement aux perceptions, elles ont tout de même contribué à améliorer la situation.
À cet égard, la question qu’il faut se poser est la suivante : que serait la situation s’il n’y avait pas eu les COP?
Avant la signature de l’Accord de Paris, les prévisions des modèles climatiques évoquaient un réchauffement de 4 degrés à l’horizon 2100, un seuil dont les effets sont difficiles à imaginer.
Aujourd’hui, on est plutôt sur une trajectoire de 2,7 degrés.
Ce n’est évidemment pas assez, mais force est de constater que la situation s’améliore. Grâce à quoi? À la baisse des coûts des énergies renouvelables et aux différentes mesures prises par les pays.
Quoi qu’on en dise, les COP exercent une pression politique et économique qui est favorable à l’action climatique.
Mais ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas réfléchir aux façons d’améliorer les choses.

2024 : année bancale pour la diplomatie environnementale
La débâcle des négociations pour un traité international sur la pollution par le plastique, le 1er décembre dernier, est le dernier exemple en date d’une diplomatie environnementale en crise.
Au terme de cinq séances de négociations tenues sur quatre continents pendant deux ans, trois pays – la Russie, l’Arabie saoudite et l’Iran – ont réussi à eux seuls à bloquer l’obtention d’un consensus international sur la réduction à la source de la production de plastique. Et tant pis pour l’entente mondiale souhaitée.
Déconfiture, aussi, lors de la COP16 sur la biodiversité à Cali en octobre dernier. Le sommet a été interrompu de façon brutale, après une nuit de prolongation, en raison de l’absence du quorum requis pour une réunion de l’ONU de cette envergure.
Les délégués avaient un avion à prendre, et le coût pour prolonger leur séjour, au regard de la maigreur des résultats attendus, les a convaincus de partir. On a reporté les discussions à février.
La COP29 en Azerbaïdjan sur les changements climatiques, en novembre, n’échappe pas non plus aux critiques, comme je le soulignais dans mon analyse « Sale temps pour le climat ».
Face à ces constats, il est légitime de se demander si une réforme est nécessaire.
C’est exactement ce qu’a fait, en pleine COP29, un groupe d’experts du domaine, parmi lesquels l’ancien secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon, l’ex-dirigeante du Secrétariat de l’ONU sur le climat Christiana Figueres et l’ex-présidente d’Irlande Mary Robinson, qui ont plaidé en faveur d’une refonte fondamentale des COP.
Quelles sont les idées sur la table?

Mieux choisir les pays hôtes?
Les COP ont lieu chaque année dans différents pays selon un système de rotation entre les cinq régions reconnues par l’ONU. À chaque groupe régional de présenter sa candidature.
Si les COP souffrent depuis quelques années d’un problème de crédibilité aux yeux du public, c’est en bonne partie, justement, en raison du choix des villes hôtes.
La COP29 était le troisième sommet sur le climat de suite à se tenir dans un pays dont l’économie dépend en grande partie de l’exploitation des énergies fossiles et qui est peu scrupuleux du respect des droits de la personne.
Avant l’Azerbaïdjan, dont le président, Ilham Aliev, a qualifié le pétrole et le gaz de don de Dieu , la COP28 avait eu lieu aux Émirats arabes unis et était présidée par Sultan Al-Jaber, président d’une compagnie pétrolière.
Pourrait-on, par exemple, exclure des pays qui ne soutiennent pas la transition énergétique hors des énergies fossiles? Ou des États dans lesquels l’élite politique et l’industrie du pétrole et du gaz sont trop imbriquées? Ban Ki-moon et ses complices proposent exactement cela : que l’ONU mette en place des « critères d’admissibilité stricts » pour « exclure » certains pays.
L’idée peut paraître séduisante, mais elle ne sera pas simple à appliquer. Quels seraient les critères d’exclusion? Par exemple, s’il était décidé d’exclure les pays producteurs d’énergies fossiles, il faudra nécessairement mettre sur la liste des pays comme le Canada, les États-Unis, la Norvège, le Royaume-Uni, l’Australie ou même le Brésil, hôte de la prochaine COP climat.
D’autant plus que la situation demande de la nuance. Par exemple, si l’expression « énergies fossiles » s’est retrouvée pour la première fois de l’histoire dans un texte officiel d’un sommet sur le climat l’année dernière, c’est beaucoup grâce au président émirati de la COP28 de Dubaï, qui en avait fait une question d’honneur.
Que penser de tous ces lobbys?
La présence croissante de lobbyistes de l’industrie du pétrole, du gaz, de la pétrochimie et de l’agro-industrie aux COP est un autre facteur qui explique la crise de confiance envers le processus onusien.
À Dubaï en 2023, ils étaient 2456 représentants de l’industrie des énergies fossiles accrédités à la COP28, soit environ 3 % de l’ensemble des délégués. C’est deux fois plus que les délégations combinées des 10 pays les plus vulnérables de la planète.
De nombreuses ONG et des représentants des pays les plus vulnérables et des petits États insulaires réclament de l’ONU qu’elle se dote d’un code d’éthique pour empêcher ces représentants de l’industrie d’avoir accès aux COP.
Ce qui est moins su, c’est que ce ne sont pas seulement les pays riches qui ouvrent la porte aux lobbyistes dans leur délégation. De nombreux pays du Sud, qui détiennent des ressources en énergies fossiles, souhaitent aussi pouvoir les accréditer. Cette volonté très répandue s’ajoute au fait que de nombreux pays – du nord comme du sud – défendent l’idée selon laquelle l’industrie des énergies fossiles doit faire partie de la solution et que les COP peuvent les inciter à investir davantage dans les énergies renouvelables.
Les positions sont très partagées à cet égard. Il est difficile d’ignorer toutefois le fait que malgré tout ce qui pourrait être fait, leur exclusion des COP ne réglerait pas le problème de leur influence dans l’élaboration des politiques nationales.
Le fameux consensus
Les conférences de l’ONU sur l’environnement fonctionnent sous le principe du consensus. Une exigence sur laquelle trébuchent souvent les COP. Au fil du temps, une petite poignée de pays ont souvent pu ralentir, édulcorer ou même bloquer des décisions qui sont pourtant prescrites par les scientifiques.
Dès la première COP en 1995 à Berlin, l’idée d’une règle d’un vote aux deux tiers, afin d’éviter qu’un petit groupe de pays puisse paralyser les discussions, a été rejetée.
Est-ce qu’un système de vote réglerait le problème? Rien n’est moins sûr.
L’exigence du consensus force les pays à faire des compromis. La pression morale joue son rôle, elle incite certains États à mettre de l’eau dans leur vin pour éviter de perdre la face.
Un vote aurait aussi le désavantage de mettre les projecteurs sur les divisions plutôt que sur le point de convergence, une situation qui pourrait apporter de l’eau au moulin des pays et des groupes qui disent que le processus se fait contre leur volonté. Et comme il faudra choisir entre deux camps, la dynamique géopolitique mondiale pourra s’immiscer davantage dans les discussions. Par exemple, quelles pourraient être les conséquences pour un petit pays africain de voter à l’opposé de la puissante Chine?
La solution idéale n’existe pas, les pays sont un peu forcés de s’entendre.
Des COP devenues trop grosses?
Les premières COP, à partir de 1995, attiraient bon an mal an 5000 personnes, avec un sursaut de 10 000 personnes lors de la COP3 en 1997, où a été signé le protocole de Kyoto, la première entente mondiale sur le climat. Environ 30 000 délégués se sont réunis dans la capitale française pour la COP21 en 2015, où on a conclu l’Accord de Paris.
Toutefois, depuis la COP26 de Glasgow en 2021, les COP battent des records d’assistance année après année. Plus de 85 000 personnes se sont rendues à Dubaï en 2023 pour la COP28, un record absolu.
L’ampleur de l’événement est-elle un gage de qualité? Pas du tout. Pour plusieurs, les COP sont devenues en partie des foires où des milliers de représentants des antennes commerciales des gouvernements et d’entreprises se rendent pour faire valoir leurs produits et leur expertise, bien loin des négociations. Certains pays en profitent même pour conclure des contrats d’énergies fossiles.
Les conséquences ne sont pas négligeables. Outre le fait qu’on a de plus en plus de difficultés à comprendre ce qui se déroule dans ces COP, il y a une inflation réelle qui en découle : dans les villes qui accueillent ces conférences, la demande est tellement grande que les hôtels deviennent hors de prix. À Bakou, le prix des chambres a été multiplié parfois par dix pendant la COP29.
Pour pallier ce problème grandissant, l’idée selon laquelle l’ONU pourrait limiter le nombre d’accréditations pour chacune des délégations circule, afin de revenir à des sommets plus modestes, et peut-être plus efficaces.
Malgré ces nombreux défauts, il serait difficile de se passer des COP. Le problème climatique, qui touche tous les pays du monde, nécessite une solution multilatérale où toutes les voix sont entendues. Ces grandes conférences sont, pour des dizaines de pays vulnérables en première ligne des changements climatiques, le seul forum où ils ont le même temps de parole que les pays riches. N’étant pas invités dans les réunions réservées aux grandes puissances comme le G20 ou le G7, les pays en développement trouvent dans les COP la seule enceinte où ils peuvent se faire entendre.
Pour pasticher Winston Churchill (une fois n’est pas coutume), les COP sont le pire des systèmes, à l’exception de tous les autres qui ont été essayés.