Ignorer le savoir traditionnel des femmes autochtones nuit à la recherche en Arctique, disent des expertes

Les connaissances traditionnelles des femmes autochtones sont trop souvent exclues de la recherche scientifique dans le nord, ce qui pourrait avoir de sérieuses répercussions sur notre compréhension de la façon dont les changements climatiques transforment le monde circumpolaire.
C’est du moins l’avis de nombreux conférenciers qui ont pris part au Sommet sur la durabilité de l’Arctique du G7 la semaine dernière, à Montréal, dans le sud-est du Canada.
« Les systèmes de connaissances autochtones sont genrés », lance d’abord Deborah McGregor, professeure à l’Université York et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la justice environnementale et les droits des peuples autochtones.
La recherche sur les changements climatiques dans l’Arctique se concentre principalement sur la chasse et le piégeage – des activités traditionnellement dominées par les hommes.
Ainsi, même si des femmes de diverses communautés remarquent que les baies et les plantes qu’elles cueillent changent de façon importante, tout comme les peaux d’animaux avec lesquelles elles créent notamment des vêtements, leurs observations se retrouvent très rarement dans la recherche scientifique ou dans les reportages des médias.

La présence d’un plus grand nombre de femmes autochtones dans des postes de direction pourrait contribuer grandement à rétablir l’équilibre, croit la professeure McGregor.
La recherche n’est pas « neutre »
Pour Karla Jessen Williamson, une professeure adjointe à la faculté d’éducation de l’Université de la Saskatchewan qui se spécialise dans les rapports entre les sexes ainsi que dans les peuples de l’Arctique et la gouvernance, la marginalisation des connaissances des femmes est un sous-produit du colonialisme vécu par les Inuits et d’autres peuples autochtones dans le monde circumpolaire.
« La recherche en soi n’est en aucun cas une chose neutre, indique cette Inuite qui a grandi au Groenland. Généralement, les chercheurs qui viennent dans l’Arctique sont des hommes célibataires qui restent trois semaines et qui repartent tout de suite. »

Elle poursuit en indiquant que dans l’Arctique, il y a toujours eu un grand respect de l’égalité des sexes. « Malheureusement, dit-elle, c’est moins le cas aujourd’hui. Les femmes reçoivent un salaire moins élevé que les hommes, ce qui n’était pas le cas il y a environ 15 ans. »
Ce n’est donc plus seulement une question de connaissances, indique la professeure. « Nous voulons être perçues comme des gens qui ont autre chose à offrir. »
Des décisions politiques qui s’appuient sur le savoir
De nombreux conférenciers ont aussi souligné qu’à l’importance des dépositaires de connaissances marginalisés s’ajoutent celle d’intégrer différents systèmes de savoir dans la recherche scientifique.
« Les femmes, ainsi que la communauté queer autochtone qui se mobilise dans l’Arctique, posent de sacrées bonnes questions quand il s’agit de science », a exposé Erin Freeland, première boursière Rhodes du Nord canadien et fondatrice du Dechinta Centre for Research and Learning, dans les Territoires du Nord-Ouest.
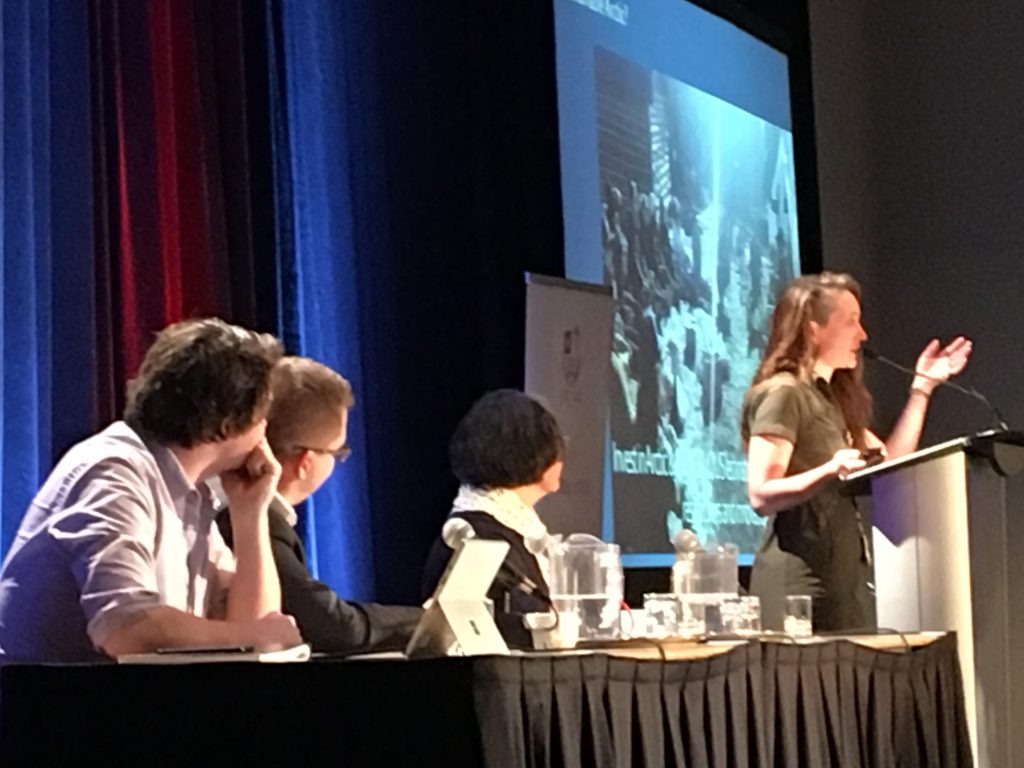
Mme Freeland a notamment expliqué comment il est essentiel de veiller à ce que ces voix, et ces intérêts, soient intégrés à la science afin de s’assurer que les décisions politiques se basent sur l’ensemble des connaissances arctiques.
« Il est absolument fondamental d’intégrer tout le monde à la science si nous voulons avoir un Arctique durable. Ces voix comptent. Elles sont là, elles doivent être écoutées », a-t-elle conclu.
– Traduit par Julien McEvoy pour Espaces autochtones



