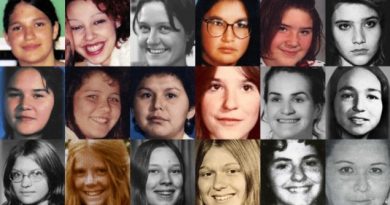Lueur d’espoir pour le retour du saumon au ruisseau Michie

Depuis 25 ans, une équipe de la Première Nation Kwanlin Dün se consacre à la conservation du saumon du ruisseau Michie, un important lieu de frai à l’est de Whitehorse, au Yukon. Elle espère ainsi être témoin du retour du roi des cours d’eau et, dans la foulée, de celui de tout un écosystème sacré pour la communauté.
L’air est frais et la brume s’élève encore du fleuve Yukon lorsque l’hydravion décolle de Whitehorse en direction du lac Michie. Durant le trajet d’une vingtaine de minutes, l’engin est secoué sous l’effet du vent. Il s’agit cependant du seul moyen de rejoindre la petite équipe de Brandy Mayes.
Sur les berges, le campement est encore monté, et le bacon crépite sur le feu. Des tentes s’élèvent entre les arbres, couvertes de rosée. L’équipe y a passé la nuit pour sa dernière excursion de l’année dans les eaux de Michie afin de comptabiliser le nombre de saumons qui sont parvenus à remonter le courant.
C’est la terre natale de mes ancêtres. Ils ont travaillé sur ce ruisseau pour s’assurer que le saumon puisse continuer à s’y rendre et frayer, raconte en souriant Brandy Mayes, la gestionnaire de la faune et de la pêche de la Première Nation Kwanlin Dün, qui poursuit aujourd’hui cette mission.

C’est en avançant lentement dans le ruisseau, de l’eau jusqu’aux cuisses et la démarche assurée malgré l’instabilité du terrain, que Brandy Mayes pointe soudain du doigt quelque chose à sa droite. À peine visible à cause du reflet du soleil, une onde rouge se rapproche. Une femelle quinnat, suivie d’un mâle, s’arrête un instant avant de repartir à toute vitesse.
À l’automne, vers la fin de leur cycle de vie, les saumons reviennent là où ils sont nés pour pondre leurs œufs et assurer la prochaine génération de poisson. Après quoi, les adultes mourront, et leurs carcasses serviront de nourriture aux autres espèces.
Le simple fait de savoir que le saumon vient jusqu’ici pour frayer et qu’il traverse 3200 km pour revenir dans ce ruisseau, c’est très spécial, et il faut le respecter, dit Brandy Mayes.
Trois fois par année depuis 25 ans, une équipe de la Première Nation parcourt le ruisseau Michie pour s’assurer qu’il n’y a pas d’obstacles empêchant les poissons de venir y pondre et féconder leurs œufs. Des troncs sont retirés, des barrages de castors sont parfois démantelés; tout est fait pour s’assurer que la voie demeure libre.
Tout ce travail en vaut la peine lorsqu’on revient ici et qu’on observe le saumon. Pour moi, il n’est jamais question d’abandonner parce que, si j’abandonne, cela veut dire que j’abandonne le saumon. Cela n’arrivera jamais, explique Brandy Mayes.
L’équipe doit ensuite compter les saumons qu’elle observe, autant ceux qui sont encore vivants et frétillants dans l’eau que les carcasses qui ont déjà été repêchées et mangées par les ours ou les aigles.

La présence de la faune environnante est indéniable. Ici et là sur le rivage, l’herbe haute a été piétinée, signe qu’un ours s’y est arrêté pour se reposer. Des traces de griffes ornent d’ailleurs certains troncs. Un martin-pêcheur survole le secteur. Au détour d’un méandre, un aigle royal attend de prendre son envol, ses ailes impressionnantes déjà déployées. La région fourmille de vie.
Lorsque le saumon revient, tous les animaux reviennent et nourrissent cette terre, et assurent qu’elle reste en bonne santé.
Le saumon est vraiment très important pour cet écosystème et celui du Yukon, rappelle-t-elle en embrassant le paysage d’un geste du bras, les yeux brillants.
Un moratoire historique pour sauver le saumon
Il n’en a toutefois pas toujours été ainsi dans le ruisseau Michie. Il y a quelques années à peine, le saumon avait complètement déserté le secteur. Le territoire enregistrait alors une baisse importante du nombre de salmonidés dans ses eaux.

En 2022, seuls 12 000 saumons quinnats sont parvenus à remonter suffisamment le fleuve pour traverser la frontière entre l’Alaska et le Yukon, ce qui est très loin de l’objectif d’une remontée de 71 000 saumons, et encore plus de la moyenne historique de 150 000 poissons.
Les causes de ce déclin sont multiples et attribuables notamment aux changements climatiques, à l’augmentation de la température de l’eau, à la surpêche et à la prévalence de certaines maladies.
Le saumon a un cycle de vie très complexe, avec une très longue migration. Il y a beaucoup de gens le long du fleuve, ce qui génère des facteurs de stress importants, explique le président du comité du saumon du Yukon et membre du comité du fleuve Yukon, Dennis Zimmermann.
Pour tenter d’inverser cette tendance et de préserver le plus possible la vie des saumons quinnats du Yukon, le Canada et l’Alaska ont signé une entente historique au mois de mai.
Pour une durée de sept ans, soit un cycle de vie complet, toutes les pêches commerciales et récréatives ont été suspendues, et ce, quelle que soit l’abondance de la montaison dans les années à venir.
Nous avons des stratégies de rétablissement, nous avons un nouvel accord; j’espère que, ensemble, nous pourrons tous commencer à poser des gestes qui auront un impact local, à plus petite échelle, comme à Michie, mais aussi tout le long du fleuve, jusqu’à la mer de Béring et même à l’étranger, affirme Dennis Zimmermann.
L’importance de la transmission d’un savoir
Cela fait un peu plus de cinq ans que la Première Nation Kwanlin Dün n’installe plus de camps de pêche sur son territoire, par crainte d’une baisse encore plus importante du saumon quinnat.
Depuis 2022, les aînés de la communauté doivent même se contenter d’un seul saumon provenant d’un territoire qui n’est pas le leur, envoyé par camion et distribué dans un stationnement en ville, loin de la nature.
Assise sur un tronc, les deux pieds dans le ruisseau Michie, Brandy Mayes rêve du jour où on pourra à nouveau mettre un filet à l’eau, même si ce n’est pas pour faire une pêche de subsistance, mais au moins pour s’assurer que ce savoir pourra être transmis à la génération suivante.
Peut-être qu’un jour, ce ne sera pas nous, mais peut-être la prochaine génération, les enfants de nos enfants pourront à nouveau pêcher le saumon quinnat. C’est ça, notre rêve, explique Brandy Mayes.
Après la chute spectaculaire du nombre de saumons, cette fois, il y a une lueur d’espoir. Environ 24 000 saumons quinnats ont remonté le fleuve et traversé la frontière cet été, soit le double de ce qui avait été enregistré il y a deux ans.
Les effets se font aussi sentir à Michie, où l’équipe de Brandy Mayes a recensé 86 saumons adultes et 55 nids de frai, soit quatre à cinq fois plus que ce qui a été observé l’année dernière.
C’est prometteur et cela nous donne de l’espoir. L’espoir, c’est ce à quoi l’on ne peut jamais renoncer, affirme Brandy Mayes.
La particularité du ruisseau Michie
Qu’est-ce qui rend le ruisseau Michie si unique et favorable au frai des saumons au point où les espoirs d’un retour des poissons sont permis dans la région? Lars Jessup, un biologiste de Whitehorse qui travaille au sein de l’équipe de Brandy Mayes, explique que toutes les conditions y sont réunies pour le saumon.
Le ruisseau Michie est un peu unique parce qu’il se situe à l’extrême amont du bassin versant du fleuve Yukon avec un lac à sa source. Les saumons aiment qu’il y ait un lac au bout d’une rivière parce que cela régule la température de l’eau et limite la formation de sédiments, explique-t-il.
Il ajoute que le ruisseau est assez long et constitué de plusieurs zones rocheuses peu profondes, idéales pour y faire un nid de frai.
Je pense aussi que le fait de poursuivre ce programme à long terme nous aide à étudier les méthodes d’adaptation du saumon, de voir la façon dont il change et d’observer sa capacité de résistance, indique Lars Jessup.
Dennis Zimmermann, du comité du saumon du Yukon, pense qu’un projet comme celui du ruisseau Michie est la preuve que les mesures de conservation sont bénéfiques et que, si on lui donne l’espace nécessaire, l’espèce peut se régénérer.
Nous avons une nouvelle relation avec le saumon, raconte Dennis Zimmermann. Ce n’est plus une relation basée sur la pêche, mais plutôt sur du travail comme celui-ci qui comporte des mesures de restauration, de surveillance, d’évaluation et une dimension culturelle. C’est ce qui est plus important aujourd’hui que jamais.
Si l’espoir a sa place, tout n’est pas pour autant gagné pour le saumon du ruisseau Michie. L’incidence de l’industrie humaine continue de menacer la survie du poisson tout au long de sa route de migration.
Brandy Mayes n’est toutefois pas près de baisser les bras. Comme les membres de sa Première Nation, elle souhaite continuer à assurer l’intendance de la région et à la protéger de tout développement qui pourrait se révéler néfaste pour l’environnement.
C’est mon rêve pour Michie : que la région ne soit pas touchée par les humains ou par le développement, par les mines ou par n’importe quelle industrie. Ce serait le rêve, conclut-elle sur un ton déterminé.
Nous allons nous battre pour cela jusqu’à la fin.
NDLR : L’empreinte écologique de cet article a été évaluée à 0,11 tonne de CO2 (dioxyde de carbone).
Ce texte fait partie de Nature humaine, une série de contenus qui présente des acteurs de changements ayant une influence positive sur l’environnement et leurs communautés en Colombie-Britannique.
| À lire aussi : |