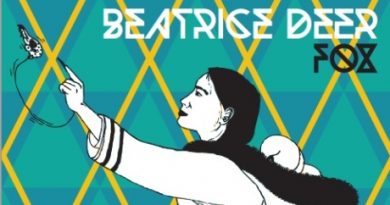Le Canada accentue sa présence diplomatique dans l’Arctique

Le Canada a dévoilé vendredi sa nouvelle stratégie de politique étrangère pour l’Arctique, qui vise à renforcer les efforts diplomatiques dans la région pour faire face à la menace grandissante que posent la Chine et la Russie dans le Grand Nord.
Le document de 40 pages dévoilé à Ottawa prévoit notamment l’ouverture prochaine de consulats en Alaska et au Groenland et la nomination d’un ambassadeur pour l’Arctique.
Le poste d’ambassadeur permettra de renforcer la coopération avec les autres pays de la région, notamment sur le plan militaire et scientifique.
Le Canada augmente sa présence militaire pour protéger l’Arctique et notre sécurité continentale, avec les États-Unis. Nous allons nous assurer d’augmenter la coopération avec nos alliés clés de l’OTAN, a déclaré la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly.

Freiner la Russie
Le gouvernement fédéral a identifié quatre grands piliers de sa nouvelle politique étrangère pour l’Arctique.
Le premier étant d’affirmer notre souveraineté, soit de favoriser la diplomatie pour soutenir les questions de défense de l’Arctique.
Ottawa compte aussi améliorer ses capacités militaires et de renseignement dans la région.
Cette volonté a déjà été exprimée lors du dévoilement de la stratégie militaire de l’Arctique, en avril dernier, qui prévoit des investissements de 73 milliards de dollars sur 20 ans.

Le gouvernement fédéral souhaite ainsi freiner l’influence grandissante de la Russie dans la région, qui a grandement investi dans ses infrastructures militaires nordiques.
Le rapprochement entre la Russie et la Chine dans l’Arctique est aussi au cœur des préoccupations du Canada.
Les deux pays ont, par exemple, récemment collaboré lors d’exercice militaire, notamment dans le détroit de Béring, ce qui démontre l’intérêt marqué de la Chine pour la région.
Nous prévoyons que cette tendance se poursuivra et qu’elle entraînera une augmentation des activités de la Chine dans l’Arctique russe, estiment les auteurs de la politique fédérale.
Une stratégie pragmatique
Le « second pilier » de la stratégie vise à promouvoir les intérêts du Canada par une diplomatie « pragmatique ».
Par cette approche, le gouvernement fédéral entend consolider ses partenariats avec ses alliés dans l’Arctique et les États-Unis.
Il est notamment question de la Suède et de la Finlande, qui ont récemment rejoint les rangs de l’OTAN.

Le gouvernement fédéral souhaite aussi faire preuve de leadership en matière de gouvernance de l’Arctique et d’enjeux multilatéraux, troisième pilier de sa stratégie.
Ottawa compte renforcer le Conseil de l’Arctique. Ce forum international, fondé en 1996, regroupe la Russie, le Canada, les États-Unis, l’Islande, la Norvège, la Finlande, la Suède, le Danemark et six organisations autochtones.
L’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 a toutefois ébranlé les relations au sein du Conseil de l’Arctique.
Inclure les communautés du Nord
Le quatrième et dernier pilier de la stratégie fédérale est l’adoption d’une approche plus inclusive de la diplomatie dans l’Arctique.
L’inclusion des communautés inuit du Grand-Nord dans la prise de décisions qui les concernent est au cœur de cette démarche.
Le président de l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), Nathan Obed, salue cette volonté. Ce dernier explique avoir longtemps grandi dans l’ombre de la militarisation de l’Arctique.
Trop souvent, les peuples autochtones ont été laissés derrière. […] Nous vivons maintenant dans un endroit où nous pouvons pleinement exercer notre autodétermination, a-t-il déclaré.

Le premier ministre du Nunavut, P.J. Akeeagok, est aussi optimiste quant à cette nouvelle politique.
La souveraineté de l’Arctique canadien est issue de l’utilisation du territoire par les Inuit. Ce sont nos familles qui ont été sacrifiées au nom du drapeau canadien, explique le premier ministre Akeeagok, en faisant référence aux nombreuses familles inuit relocalisées dans l’extrême arctique pour peupler la région.
Notre territoire est prêt à renforcer nos liens diplomatiques. C’est nos terres et nos eaux qu’il est question, ajoute-t-il.
Le volet de diplomatie internationale de cette nouvelle politique prévoit des investissements de 7 millions de dollars par an, pour les cinq prochaines années.
À lire aussi :