Assurer la continuité d’un service d’aide en santé mentale au Nunavut

Au moment où l’une des fondatrices de Kamatsiaqtut envisage sa retraite, la hausse de la demande pour son service de soutien dans le Nunavut souligne la nécessité de mettre en place un plan de relève.
Selon Sheila Levy, le service d’écoute téléphonique n’avait que des capacités très limitées lors de son lancement en 1990. Cependant, les fondateurs étaient déterminés à agir après une série de suicides dans la région du Qikiqtani.
Nous avions suffisamment de [financement] pour avoir droit à un placard, littéralement un placard, dans un bureau
, se souvient-elle. Nous avons ensuite obtenu un numéro de ligne d’aide de la part de Bell Canada.
Aujourd’hui, 35 ans plus tard, cette ligne demeure une oreille attentive pour les personnes qui habitent le Nunavut, le Nunavik, mais aussi ailleurs.
Pour nous, c’est la norme
Depuis le lancement de la ligne d’aide nationale 988 en 2023, un certain nombre d’appels émanant du Nunavut ont été redirigés vers Kamatsiaqtut. Cela a mis en évidence l’importance de ce service pour Yuri Podmoroff.
Certains partenaires du 988 ne répondent pas aux appels des jeunes, affirme l’agent administratif de Kamatsiaqtut.D’autres avaient besoin de guides pour gérer les personnes sur la ligne qui sont violentes ou sous l’influence de l’alcool ou de la drogue. Pour nous, c’est la norme.
Selon Inuit Tapiriit Kanatami, le taux de suicide est de 5 à 25 fois plus élevé dans les communautés inuit que dans le reste du Canada. En juin, le gouvernement nunavois a déclaré une crise du suicide.
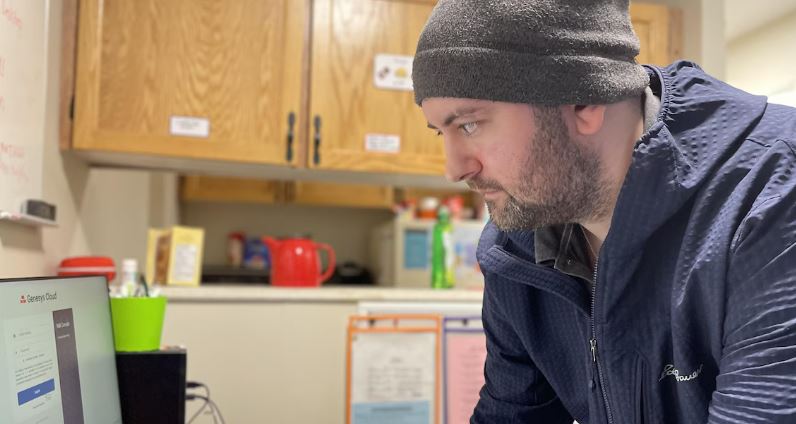
La sensibilisation se poursuit toujours
Le financement et l’éloignement des communautés représentent toujours un défi pour la direction du service.
Sheila Levy explique qu’ils dépendent des bénévoles et reçoivent 150 000 $ par an du gouvernement territorial.
Bien que les résidents puissent appeler la ligne à tout moment, elle ne fonctionne que pendant cinq heures chaque soir depuis le Nunavut. Le reste du temps, c’est le Centre de détresse d’Ottawa qui répond aux appels.
Malgré tout ce temps écoulé, Sheila Levy persiste à croire qu’il y a encore un travail de sensibilisation à faire auprès du public concernant l’existence de ce service. Elle admet que, comme il ne peut pas se permettre d’envoyer du personnel dans les communautés, il se contente d’envoyer des affiches, des aimants et des cartes et d’espérer qu’ils seront partagés avec d’autres.
Yuri Podmoroff ajoute que le service cherche également à rencontrer des personnes à l’hôpital.
De cette façon, elles savent qu’elles peuvent parler à quelqu’un si elles en ressentent le besoin.
Un poids émotionnel
Yuri Podmoroff affirme que le fait de répondre aux appels entraîne un certain risque émotionnel pour les bénévoles, puisque plusieurs d’entre eux ont vécu un traumatisme.
Ceux qui sont en mesure de répondre le mieux à cette demande sont ceux qui ont vécu les deux côtés. Ils ont traversé beaucoup d’épreuves, ils peuvent maintenant tendre la main à autrui, mais cela peut aussi les replonger dans une mauvaise passe.

Kathy Hanson est bénévole depuis une trentaine d’années. Bien qu’elle ne trouve pas cela facile, elle est convaincue que l’aide apportée aux autres Inuit en vaut la peine.
Lorsqu’ils entendent que c’est un Inuk à l’autre bout du fil, ils pleurent, car ils savent que c’est quelqu’un comme eux, qui va les comprendre, affirme Kathy Hanson, bénévole, Kamatsiaqtut.
Selon elle, la possibilité de s’exprimer dans sa propre langue est d’une importance capitale.
Elle cite des exemples d’Inuit vivant en milieu urbain qui appellent en souhaitant parler en inuktitut. Elle évoque également des personnes incarcérées qui désirent elles aussi s’exprimer dans leur langue maternelle, ou encore qui veulent simplement dire que le Nunavut leur manque
.
Elle comprend les gens qui hésitent à demander de l’aide, mais les supplie néanmoins de le faire et d’obtenir l’aide dont ils ont besoin.
Quelqu’un attend vos appels, et j’espère que vous le ferez, car vous comptez énormément, dit-elle à leur intention.
Avec les informations de Samuel Wat
À lire aussi :



