50 ans de droit de vote autochtone au Québec
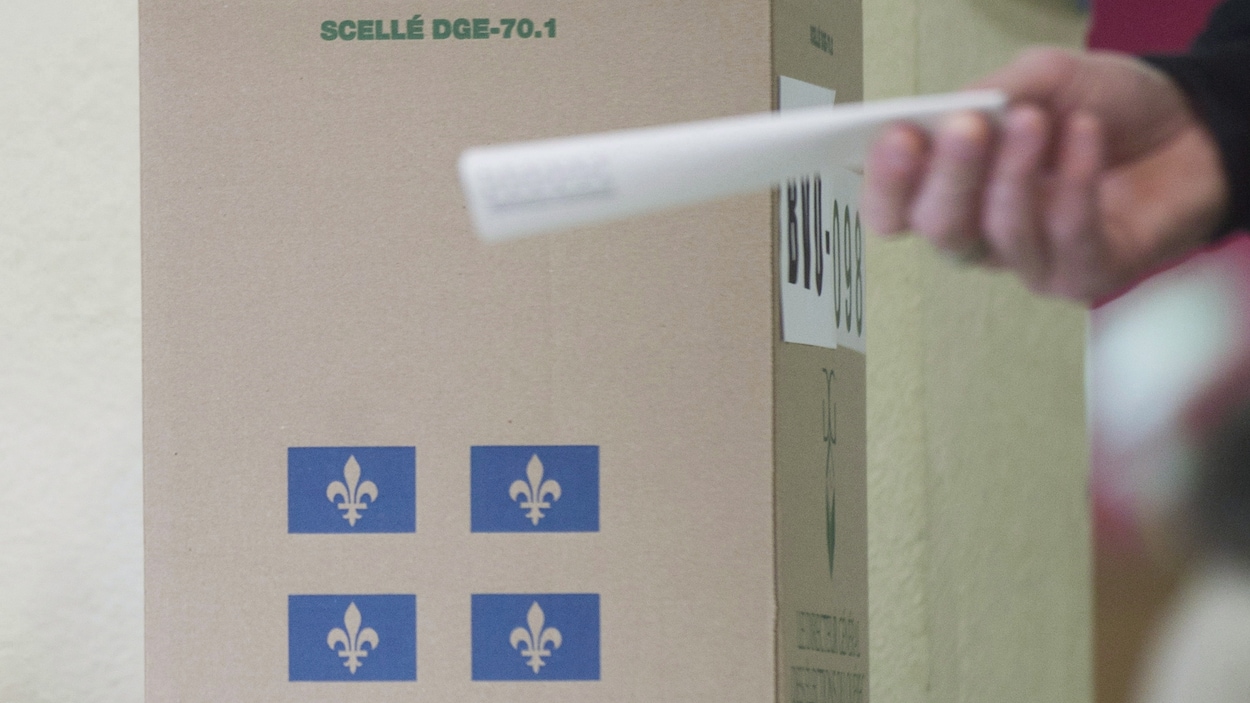
Le 2 mai 1969, le Québec devenait la dernière province canadienne à élargir le droit de vote aux Premières Nations. Le gouvernement fédéral l’avait fait en 1960, quand John Diefenbaker était premier ministre. Cinquante ans ont passé depuis que les Autochtones sont citoyens à part entière au Québec, et pourtant leur participation à la démocratie est loin d’être acquise.
Cuisinier de formation, Patrick Boivin fait ses premiers pas en politique. À 45 ans, il vient d’être élu au Conseil de bande des Atikamekw de la communauté de Wemotaci, située à plus de 100 km au nord-ouest de La Tuque.
L’engagement politique coule dans ses veines : son père a été chef, son grand-père aussi, quand Wemotaci n’était qu’un camp de fortune pour un peuple encore semi-nomade.
Les Autochtones vivaient alors comme si le Québec n’existait pas. Un isolement à la fois volontaire et imposé, à l’époque où les Autochtones n’ont pas même le droit de voter.
Les choses ont bien changé, reconnaît le nouveau conseiller, même si le 1er octobre dernier il a fait comme ses ancêtres et il est resté chez lui. « Je n’ai même pas voté… j’ai suivi ça un peu, mais tu te dis que c’est toujours la même histoire. »

Faible participation
Patrick Boivin est loin d’être le seul à ne pas s’être déplacé aux dernières élections.
Bien que les Premières Nations aient le droit de vote depuis maintenant un demi-siècle, le taux de participation demeure famélique dans les communautés.
À Wemotaci, il atteint à peine 10 % le 1er octobre dernier, alors qu’il est d’un peu moins de 12 % à Uashat mak Mani-Utenam, communauté innue à l’est de Sept-Îles et de 6 % chez les Algonquins de Kitigan Zibi en Outaouais.
Aucune étude exhaustive n’a encore été réalisée sur la participation des Autochtones aux élections provinciales, et le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) ne compile pas de données séparées pour les Premières Nations, mais un portrait existe, grâce au recensement des votes par secteur.
Une affaire de culture ou de désaffection?
Selon le chef actuel de Wemotac, François Néashit, l’indifférence à la politique québécoise s’explique avant tout par la culture distincte et l’histoire des peuples autochtones.
Il n’empêche que le taux de participation des Autochtones aux élections fédérales est beaucoup plus important. Selon Élections Canada, il était de 62 % à l’échelle canadienne en 2015. C’est au Québec que les Autochtones se sont le moins déplacés, avec un taux de participation de 41 %.
Désengagement politique

Le tableau n’est guère plus reluisant en matière d’engagement politique. Depuis l’obtention du droit de vote, le péquiste Alexis Wawanoloath a été le seul Autochtone à siéger à l’Assemblée nationale.
Le grand chef atikamekw Constant Awashish n’exclut pas d’être le deuxième à franchir les portes du Salon bleu, mais il comprend le peu d’enthousiasme que suscite la politique québécoise chez les siens.
« Il y en a qui disent que ce n’est pas notre système à nous, qu’on ne peut pas participer dans ces élections-là. Alors que d’autres disent : il faut participer, il faut changer les choses de l’intérieur. »
Il reconnaît que le lien est ténu avec Québec, puisque les services offerts dans les communautés, comme la santé et l’éducation, relèvent d’abord du gouvernement fédéral.
Pourtant, étant donné que l’exploitation des ressources naturelles est de responsabilité provinciale, un rapprochement avec Québec est inévitable, selon lui.
Le Québec en retard
Le politologue de l’Université de Montréal spécialisé dans les questions autochtones Martin Papillon soutient que ce désengagement ne signifie pas que les Autochtones sont apathiques.
Il est plutôt d’avis qu’un changement s’opère, lentement mais sûrement. Surtout chez les jeunes, moins isolés grâce aux nouvelles technologies, mais pour qui l’attachement aux provinces demeure limité.
« On devrait être sensibles comme Québécois à la volonté de maintenir la langue, l’identité et le lien à l’endroit où l’on vit, et paradoxalement, on en fait très peu au Québec pour les Autochtones. »

Il note que l’Alberta et la Colombie-Britannique ont été plus proactives pour favoriser l’engagement des Premières Nations, et une meilleure entente entre les provinces et les Autochtones.
Un effort mutuel
Une relation n’est pas une voie à sens unique, rappelle la ministre des Affaires autochtones, Sylvie D’Amours.
En poste depuis un peu plus de six mois, elle se dit à l’écoute et ouverte à négocier de nation à nation. Elle croit cependant que les Autochtones ont aussi leur part de responsabilité.
La ministre D’Amours estime, par ailleurs, que c’est grâce au développement économique que les Premières Nations prendront leur place au sein de la démocratie québécoise.



