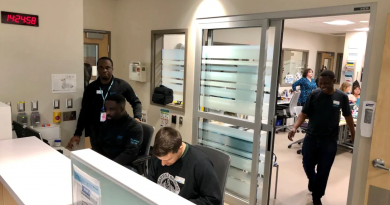Des chercheurs québécois inaugurent une collaboration d’envergure avec les Inuit

Une équipe d’experts de l’Université de Sherbrooke au Québec mise sur une collaboration avec le savoir traditionnel d’une dizaine de communautés inuit de l’Arctique pour mieux comprendre les effets des changements climatiques sur le comportement et la survie des animaux de la région comme le bœuf musqué et le caribou de Peary.
Le projet, considéré comme majeure par l’institution québécoise et financé à hauteur de 1,8 million de dollars par le programme Alliance du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), a également l’objectif de documenter les bouleversements qui ont lieu sur la glace de mer, le couvert nival et le pergélisol du Grand Nord.
« L’Arctique se réchauffe trois fois plus vite que les autres régions du monde. Pour une espèce, s’adapter à des changements qui arrivent sur 20 ou 30 ans, c’est impossible », déclare Alexandre Langlois, professeur à l’Université de Sherbrooke et directeur du projet.
Selon les études des scientifiques, les changements climatiques qui modifient le couvert de neige et la végétation dans l’archipel Arctique canadien touchent différentes espèces animales. « On dit que l’Arctique se réchauffe et qu’il va donc y avoir plus de lichen pour l’alimentation de ces espèces. Mais on possède peu d’information sur le type de lichen qui reverdit le Nord, et si ce lichen est comestible pour le caribou », précise le professeur.
À ce titre, le caribou de Peary et le bœuf musqué sont deux espèces « essentielles » de l’alimentation des communautés inuit. Les experts ont d’ailleurs observé en 2016 une diminution draconienne de 70 % sur trois générations de leur population, une véritable catastrophe pour les Autochtones.
Pour M. Langlois, le savoir traditionnel des communautés inuit est important pour la recherche, car il permet aux scientifiques de répondre à plusieurs questions telles que la variation des événements climatiques à travers les années ou les tentatives d’adaptation.
« Dans un contexte de changements climatiques, il faut remettre en question les voyages en avion pour aller prendre des mesures, alors qu’il y a des gens sur place qui sont amplement compétents pour le faire, mentionne-t-il. En plus, on bénéficie d’un savoir traditionnel. J’ai appris assez rapidement la richesse de ce savoir phénoménal. C’est une culture de recherche qui change. »
Le professeur rappelle que les Inuit veulent participer à la prise de décision, à la gouvernance, aux priorités du projet scientifique. « Ce ne sont plus juste des témoins de passage et des techniciens de terrain.. Ils veulent participer à l’élaboration des objectifs de la science, à l’analyse qu’on fait de leurs données, et ils veulent avoir leur mot à dire sur les décisions qui seront prises ensuite », conclut-il.